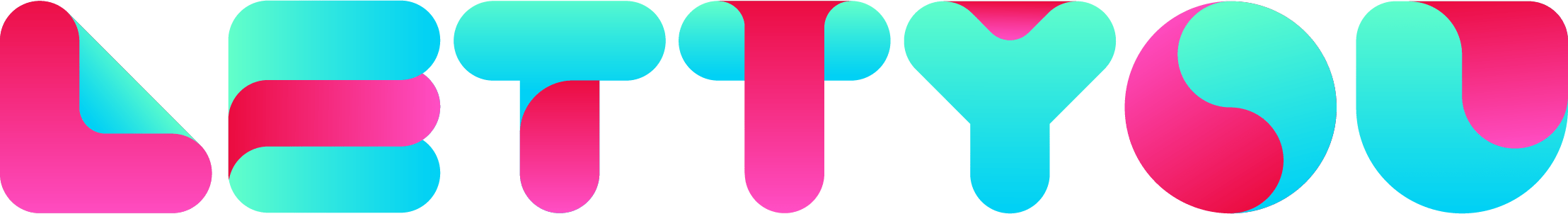AUTRES
Bushidô, le code du Samouraï par Inazo Nitobe – Chapitre 1
Publié
2 ans avantle

Préface de Inazo Nitobe
Il y a environ dix ans, tandis que je passais quelques jours sous le toit accueillant de l’éminent économiste belge – le regretté M. de Laveleye – au cours d’une de nos promenades, notre conversation s’orienta sur le thème de la religion : « Voulez-vous dire, me demanda le vénérable professeur, qu’il n’y a aucune instruction religieuse dans vos écoles ? » Lorsque je répondis par la négative, il s’arrêta soudain, médusé, et d’une voix que je ne suis pas prêt d’oublier, il répéta : « Pas de religion ! Mais comment enseignez-vous l’éducation morale ? » La question me laissa sans voix. Je n’avais pas de réponses toute faite. Les préceptes moraux que j’avais appris dans mon enfance ne m’avaient pas été inculqués à l’école, et ce n’est que lorsque je commençai à analyser les différents éléments qui avaient formé mes notions du bien et du mal que je découvris que c’était l’esprit du Bûshido qui m’avait insufflé ces notions.
Ce petit livre a vu le jour suite aux fréquentes questions de ma femme, qui cherchait à savoir pour quelles raisons certaines idées et coutumes prévalaient au Japon.
Lors de mes tentatives pour apporter des réponses satisfaisantes à M. de Laveleye et à ma femme, j’ai découvert que sans une compréhension profonde du féodalisme et du Bushidô, les notions morales du Japon actuel étaient aussi accessibles que des informations consignées dans un livre scellé.
Profitant du repos forcé des suites d’une longue maladie, j’ai couché sur le papier, telles que je les présente aujourd’hui, certaines des réponse que j’ai apportées lors de nos conversations privées. Elles étaient surtout inspirées de ce qu’on m’avait enseigné et dit dans ma jeunesse, au temp ou la féodalité régnait encore.
Il est très décourageant d’écrire quoi que ce soit sur le Japon en langue anglaise dans l’ombre imposante de Lofcadio Hearn et de Mme Hugh Fraser d’un côté, de Sir Ernest Satow et du professeur Chamberlain de l’autre. Le seul avantage que j’aie sur eux est que je peux endosser le rôle du défenseur de ma cause, tandis que ces écrivains distingués sont au mieux des avocats et des procureurs. J’ai souvent pensé : « Si j’avais leur maîtrise de la langue, je présenterais le Japon en des termes plus éloquents ! » Mais celui qui s’exprime dans une langue d’emprunt devrait être reconnaissant si il parvient seulement à se faire comprendre.
Tout au long de mon texte, j’ai essayé d’illustrer les points que j’ai abordés avec des exemples empruntés à l’histoire et la littérature européennes, dans le but d’en faciliter la compréhension pour le lecteur étranger.
Inazô Nitobe, Malvern, Pennsylvanie, décembre 1899
Le Bushidô en tant que système éthique
La chevalerie (Bushidô) est une fleur née sur le sol du Japon, dont elle n’est pas moins représentative que son emblème, la fleur de cerisier. Pourtant, elle n’est en rien le spécimen desséché d’une vertu antique conservée dans l’herbier de notre histoire. Elle est toujours vivante parmi nous, dans toute sa puissance et sa beauté, et même si elle ne possède ni forme ni contour tangible, son parfum flotte toujours dans l’atmosphère morale et nous fait prendre conscience qu’elle exerce encore sur nous sont puissant sortilège. Les conditions sociales qui l’ont engendrée et nourrie ont depuis longtemps disparu, mais tout comme ces étoiles lointaines qui ont existé et ne sont plus, elle continue de nous éclairer. De cette manière, la lumière de la chevalerie, fille de la féodalité, illumine toujours les cheminements de notre morale, survivant ainsi à l’institution qui lui a donné naissance. C’est un plaisir pour moi de méditer sur ce sujet dans la langue de Burke (Edmund Burke, homme politique et philosophe irlandais), qui, au moment où la chevalerie européenne tombait dans l’oubli, a prononcé un célèbre et touchant éloge funèbre sur sa dépouille.
Lorsqu’un homme aussi érudit que George Miller (History Philosophically Illustrated, 1853) n’hésite pas à affirmer que la chevalerie, ou toute autre institution similaire, n’a jamais existé, que ce soit parmi les nations de l’antiquité où dans le monde oriental moderne, cela témoigne d’un triste manque d’informations sur l’Extrême-Orient. Une telle ignorance est cependant bien excusable, étant donné que la troisième édition de l’ouvrage de Miller est parue l’année même où Commodore Perry (Le Commodore Perry, à la tête d’une escadre américaine, jeta l’ancre, en 1853, dans la baie d’Edo. Il réussit, l’année suivante, à obtenir du Japon un traité de commerce et l’ouverture d’un port) frappait aux portes de notre isolationnisme. Plus de dix ans plus tard, à peu près à l’époque où notre féodalité à l’agonie vivait ses derniers instants en écrivant Le Capital, Karl Max attirait l’attention de ses lecteurs sur l’intérêt d’étudier les institutions sociales et politiques de la féodalité, qui à cette époque ne vivait plus qu’au Japon. Je voudrais à mon tour inviter les Occidentaux qui s’intéressent à l’histoire et à l’éthique à étudier le Bushidô dans le Japon actuel.
Aussi séduisante que puisse être la comparaison historique entre la féodalité et la chevalerie en Europe et au Japon, mon but n’est pas de développer ce sujet dans ce livre. Je souhaite plutôt relater : 1) les origines et les sources de notre chevalerie; 2) sa nature et son enseignement; 3) son influence sur le peuple; 4) la continuité et la permanence de cette influence. Parmi ces différents points, le premier sera bref et synthétique, pour éviter d’entraîner mon lecteur dans les tortueux méandres de notre histoire nationale. Le second sera plus développé, car il est celui qui sera le plus susceptible d’intéresser ceux qui veulent connaître notre éthique et nos moeurs, notre façon de penser et d’agir. Le reste sera traité comme corollaire.
L’expression japonaise que j’ai grossièrement désignée sous le terme de chevalerie est bien plus expressive dans sa langue d’origine. Bu-shi-dô signifie littéralement «La voie du guerrier» – la façon dont les nobles guerriers devraient se comporter dans leur vie quotidienne, comme dan leur vocation ; autrement dit, les « Préceptes de la Chevalerie », la « noblesse oblige » de la classe des guerriers. À présent que j’en ai donné le sens littéral, je vais désormais pouvoir employer le mot dans sa forme originale : Bushidô. L’emploi du terme d’origine est également souhaitable pour une autre raison : un enseignement aussi circonscrit et unique, qui a engendré une véritable tournure d’esprit, un caractère aussi particulier et local, doit afficher le badge de sa singularité. De plus, certains mots ont un timbre si expressif des caractéristiques d’une nation, que même les meilleurs traducteurs ne peuvent leur rendre justice. Qui peut, par la traduction, mieux communiquer le sens du mot allemand « Gemüth » (Noble coeur, belle âme en allemand) ? Qui ne sent pas la différence entre deux mots si étroitement liés que le gentleman anglais et le gentilhomme français ?
Ainsi le Bushidô est le code des principes moraux que les chevaliers étaient tenus d’observer. Ce n’est pas un code écrit; il est au mieux constitué de quelques maximes transmises de bouche à oreille, ou quelquefois nées sous la plume de quelque chevalier ou érudit célèbre. Lais le plus souvent, ce code n’est ni prononcé ni écrit, ce qui ne lui donne que plus d’autorité. Et cette autorité fait loi, gravée à même le coeur. Il n’est pas le fruit de la création d’un seul cerveau, aussi brillant fût-il, ni issu de la vie d’un seul personnage, aussi renommé fût-il. Il a poussé sur le sol fertile de décennies et de siècles de carrière militaire. Il occupe peut-être la même place dans l’histoire de la morale que la Constitution anglaise dans l’histoire de la politique; pourtant, il n’a rien de comparable avec la Magna Carta ou l’Habeas Corpus. Certes, au début du XVIIé siècle, des lois militaires (Buké Hatto) ont été promulguées; mais leurs treize courts articles concernaient principalement le mariage, les châteaux, les alliances, etc. Et les règles morales n’étaient abordées que de façon succincte. Nous ne pouvons donc pas pointer du doigt un moment et un lieu définit et dire : « C’est là que tout a commencé. » Ce n’est que parce qu’il atteint les consciences à l’époque féodale que son origine peut-être associé à la féodalité. Mais la féodalité est elle-même tissée de nombreux fils, et le Bushidô partage sa nature complexe. Si on considère qu’en Angleterre les institutions politiques et la féodalité datent de la conquête normande, ont peut dire qu’au Japon, son essor à coïncidé avec l’accession au pouvoir de Yoritomoto, à la fin du XIIé siècle. Et si, en Angleterre, les germes de la féodalité sont bien plus anciens et remontent à avant Guillaume le Conquérant, il en est de même pour le Japon, où elle prend sa source bien avant la période que je viens de mentionner.
D’ailleurs, au Japon comme en Europe, lorsque la féodalité fut officiellement inaugurée, la classe professionnelle des guerriers a naturellement pris de l’importance. On les connaissait sous le nom de samouraïs, ce qui signifie, au sens littéral – comme l’ancien mot anglais cniht (knecht, knight) – « gardes » ou « serviteurs ». Ils sont comparables aux soldurii, dont César mentionne l’existence en Aquitaine, ou aux comitati qui, selon Tacite, ont suivi les chefs militaires de leur époque, ou pour faire un parallèle avec une période plus récente, aux milites medii qui apparaissent dans l’histoire de l’Europe médiévale. Le terme sino-japonais buké ou bushi (chevaliers combattants) a également été adopté dans le langage courant. Ils appartenaient à une classe privilégiée, et étant d’un tempérament ardent, ils avaient fait du combat leur vocation. Cette classe était naturellement alimentée, durant une longue période de guerres incessantes, par les hommes les plus virils et les plus aventureux, et tandis que le processus d’élimination était à l’oeuvre, écartant les timides et les faibles, seule restait « une race dure, d’hommes puissants animés par une force animale », pour emprunter la phrase d’Emerson, survivant pour former la classe des samouraïs. Ils accédèrent aux honneurs et aux grandes responsabilités qui les accompagnent et ne tardèrent pas à ressentir la nécessité de règles de conduites communes, en particulier parce qu’ils étaient toujours sur le pied de guerre et qu’ils étaient divisés en différents clans. À l’instar des médecins qui limitent la concurrence entre eux par déontologie, ou des hommes de loi qui siègent au tribunal d’honneur pour une violation d’étiquette, les écarts de conduite de guerriers doivent eux aussi être jugés.
Le combat dans les règles ! Quels germes féconds dans ce sentiment primitif qui est l’apanage de la sauvagerie et de l’enfance. N’est-ce pas l’origine de toutes les vertus militaires et civiques ? Nous sourions (comme si nous avions grandi et évolué!) devant le désir enfantin du petit Anglais, Tom Brown, « de laisser derrière lui la réputation d’un garçon qui n’a jamais brimé un plus petit ni tourné le dos à un plus grand. Et pourtant, qui ignore que ce désir est la pierre angulaire sur laquelle les plus grands édifices moraux peuvent s’élever ? Et sans aller aussi loin, ne peut-on dire que la plus douce et la plus pacifiste des religions caresse cette aspiration ? Le désir de Tom est la base principale sur laquelle la grandeur de l’Angleterre s’est construite, et nous ne serons pas longs à découvrir que le Bushidô ne s’appuie pas sur un piédestal moins prestigieux. Si le combat en soi – qu’il soit offensif ou défensif – est, comme les quakers le déclarent avec raison, brutal et mauvais, nous pouvons malgré tout affirmer, à l’instar de Lessing, que « Nous savons de quels défauts naît notre vertu. » « Traîtres » et « lâches » sont les épithètes les plus avilissantes pour des natures simples et saines. L’enfance commence la vie forte de ces notions, et il en est de même pour la chevalerie, mais, à mesure que la vie se complexifie et que les relations se multiplient, la foi primitive cherche l’approbation d’une plus haute autorité et de sources plus rationnel qui puissent la justifier, la satisfaire et l’aider à se développer. Si les intérêts militaires avaient oeuvré seuls, sans référence à une morale supérieure, les guerriers n’auraient jamais atteint l’idéal de chevalerie ! En Europe, le christianisme sut faire quelques concessions à la chevalerie, ce qui ne l’empêcha pas de lui insuffler ses valeurs spirituelles. « La religion, la guerre et la gloire étaient les trois âmes du parfait chevaliers chrétiens », selon Lamartine. Au Japon, les sources du Bushidô furent multiples.

Notes sur l’auteur : Qui est Inazo Nitobe ?
Né en 1862, Inazô Nitobe a commencé à apprendre l’anglais à l’âge de neuf ans. Il fut élève à l’école agricole de Sapporo, puis entra à l’Université Impériale de Tokyo en 1883, où il étudia l’astronomie et la littérature anglaise. Il a ensuite voyagé aux États-Unis, où il a suivi des études en politique et relations internationales à l’Université John hopkins, entre 1884 et 1887. Il résida en Allemagne à partir de 1887, où il a étudié dans plusieurs universités et obtenu un doctorat en économie agricole. Lorsqu’il rentre au Japon en 1891, il a déjà publié des livres en anglais et en allemand. Nitobe enseigna à l’école agricole de Sapporo de 1891 à 1897, avant de prendre un congé sabbatique. Durant cette période, il a passé du temps en Californie et en Pennsylvanie, où il a écrit Bushidô : l’âme du Japon, qui a été publié en 1900.
Entre 190 et 1919, il occupa un poste de professeur à l’Université impériale de Kyoto et devint professeur du premier lycée de Tokyo. Il a également oeuvré dans la diplomatie, travaillant en tant qu’administrateur d’une colonie à Taïwan entre 1901 et 1903. Après la fin de la Première Guerre Mondiale, il a participé à la conférence internationale de la paix de Versailles en 1918, puis est devenu secrétaire générale adjoint de la société des Nations nouvellement créée. Il fut également nommé Président du Conseil pour l’Océan Pacifique de 1929 à 1933. En 1933, tandis qu’il est à la tête d’une délégation japonaise lors d’une conférence internationale au Canada, il est victime d’une pneumonie, et meurt à l’hôpital Victoria, en Colombie britannique.
Nitobe fut un écrivain prolifique. Il a publié de nombreux textes universitaires, ainsi que des livres destinés à un plus large public. En Occident, Bushidô : l’âme du Japon a été un best-seller depuis le début de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, et a été traduit dans des dizaines de langues.

Vous aimerez aussi


Voyager et ses illustrations en dehors du temps et de l’espace


La série de photos Dream World de Anthony Presley


Les extraordinaires illustrations du studio Goodname


Les captivantes illustrations de Kotaro Chiba


Les émouvantes illustrations de Nicolás Castell


Le Japon à travers l’objectif d’Anthony Presley
ON SE RETROUVE SUR INSTAGRAM ?

Sam Dunn et ses créatives illustrations

La cryptozoologie vue par Camille Renversade

Et si Edward aux Mains d’Argent sortait en 2023 ?

Final Fantasy VIII : Un voyage épique dans le monde de la sorcellerie

Les marques médiévales de Ilya Stallone
Tendance

 MUSIQUE2 ans avant
MUSIQUE2 ans avantL’interview de Vindu, la nouvelle génération lofi hip-hop

 VIDÉO4 ans avant
VIDÉO4 ans avantLes animations hypnotisantes d’Andreas Wannerstedt

 TATOUAGE4 ans avant
TATOUAGE4 ans avantChen Jie et ses tatouages dignes des grands maîtres de l’estampe

 ILLUSTRATION4 ans avant
ILLUSTRATION4 ans avantAvogado6 et ses sombres et significatives illustrations

 SHOPPING4 ans avant
SHOPPING4 ans avantLes robes de mariées inspirées des princesses Disney de Kuraudia

 ILLUSTRATION4 ans avant
ILLUSTRATION4 ans avantLe monde dystopique de la pop-culture par Filip Hodas

 ILLUSTRATION3 ans avant
ILLUSTRATION3 ans avantGuillem Daudén, alias Kenji893 the DragonBall Samurai guy

 ILLUSTRATION4 ans avant
ILLUSTRATION4 ans avantLes mondes en Low Poly de Pavel Novák